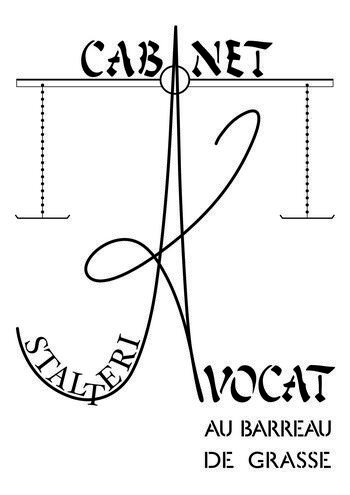Sélection d’arrêts : autorité parentale, couple, divorce, indivision, libéralités et successions
Cette fois, l’activité jurisprudentielle a bien repris tambour battant. Voici notre sélection de la semaine : autorité parentale, couple, divorce, indivision, libéralités et successions.

AUTORITÉ PARENTALE
Compétence du juge français lorsqu’aucun autre juge n’est compétent pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale consécutives au divorce (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 19-24.779) – Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement « Bruxelles II bis », la compétence est, dans chaque État, réglée par la loi de cet État (Règl. « Bruxelles II bis », art. 7). Cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. L’article 14 du code civil, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France. Une cour d’appel ne pouvait donc dire que le juge français n’était pas compétent à l’égard de la demande relative à la responsabilité parentale, après avoir constaté qu’aucune juridiction française n’était compétente en application des articles 3 du Règlement « Bruxelles II bis » et 1070 du code de procédure civile. Car il l’était sur le fondement de l’article 14 du code civil !
Retards dans la procédure fixant les modalités de visite du père à son enfant en violation de son droit au respect de sa vie familiale (CEDH, 23 sept. 2021, n° 46075/16)
COUPLE
Ordonnance de protection : refus de renvoi d’une QPC en ce que l’article 515-11 du code civil porterait atteinte à la présomption d’innocence, violerait les droits de la défense et porterait atteinte à la liberté d’aller et venir (Civ. 1re, QPC, 16 sept. 2021, 21-40.012) – D’abord, les mesures que le juge aux affaires familiales peut prononcer sur le fondement de l’article 515-11 du code civil, s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, reposent non sur la culpabilité de la partie défenderesse, mais sur sa potentielle dangerosité appréciée par le juge à la date de sa décision. Ayant pour but d’empêcher et de prévenir des faits de violence sur la partie demanderesse ou ses enfants, elles ne constituent ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que le principe de la présomption d’innocence ne trouve pas à s’appliquer. Ensuite, si ce même article prévoit que l’ordonnance de protection est délivrée, par le JAF, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, ce délai, qui n’est assorti d’aucune sanction, a pour objectif d’empêcher, au cours d’une procédure diligentée dans l’urgence, un risque particulier de violence à l’égard d’une personne ou de ses enfants, tout en octroyant au défendeur les moyens de préparer utilement sa défense et la faculté d’être entendu lors de l’audience, outre que, selon l’article 1136-6 du code de procédure civile, le juge saisi s’assure, à l’audience, qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la convocation pour que le défendeur ait pu présenter sa défense. Enfin, si le juge peut, en application de l’article 515-11, 1o bis, interdire pour une durée de six mois à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse, une telle mesure est justifiée par l’objectif de santé publique de lutte contre les violences conjugales. Limitée dans le temps et dans l’espace, elle n’entrave pas de manière disproportionnée la liberté d’aller et de venir de la personne à laquelle elle est appliquée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
DIVORCE
Prestation compensatoire : refus de renvoi d’une QPC relative à l’article 270 du code civil en ce qu’il méconnaîtrait le droit de propriété et porterait atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage (Civ. 1re, QPC, 14 sept. 2021, n° 21-12.128) – D’abord, en ce que l’article 270 du code civil – qui régit, en ses deuxième et troisième alinéas, la décision judiciaire d’allouer ou non une prestation compensatoire – tend à la reconnaissance éventuelle d’un droit de créance, il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789, faute de privation du droit de propriété au sens de cette disposition, mais reste soumis aux exigences de l’article 2 de la Déclaration de 1789, selon lequel les limites apportées à l’exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi (Cons. const., 12 nov. 2010, n°°10-60 QPC, § 3).
Ensuite, si les limites apportées à la liberté de mettre fin aux liens du mariage, découlant des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et justifiées par l’intérêt général doivent également être proportionnées à l’objectif poursuivi (Cons. const., 29 juillet 2016, n° 2016-557 QPC, § 5) :
. les dispositions critiquées ont pour finalité d’assurer la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable, objectif dont la valeur a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (§ 6) ;
. le juge peut refuser d’accorder la prestation compensatoire déterminée, après un débat contradictoire sur son principe et son montant, au regard des critères de l’article 271 du code civil, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En conclusion, compte tenu des conditions et garanties procédurales encadrant l’octroi de la prestation compensatoire, l’atteinte portée à l’exercice du droit de propriété et à la liberté de mettre fin aux liens du mariage par les dispositions contestées apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les questions posées au Conseil constitutionnel.
NB – On se réjouira de cette décision, qui rappelle que la prestation compensatoire ne saurait être vue comme une atteinte au droit de propriété au sens de l’article 17 de la DDHC de 1789. Dans le jargon propre au droit constitutionnel (qui laisse toujours un brin songeur), la Cour de cassation explique ensuite de façon fort claire que le droit à prestation compensatoire correspond à un objectif de protection du conjoint qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel et qu’il est, au surplus, encadré puisqu’il repose, d’une part, sur des critères légaux (ceux de l’article 271 c. civ.) et, d’autre part, que ces critères légaux sont eux-mêmes soumis au débat contradictoire lors de l’instance en divorce.
Le lecteur peut donc se rassurer, la prestation compensatoire est encore défendue en haut lieu ! Cela dit, tout ceci enfonce quelques portes ouvertes. Que serait en effet le droit du divorce si l’on devait admettre que la prestation compensatoire constitue une atteinte au droit de propriété ? Décidément, le système des QPC est parfois bien étrange, ouvrant la voie à des discussions qu’il vaut mieux prendre au deuxième ou au troisième degré…
Le juge, pour fixer le montant d’une indemnité d’occupation, ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-11.939) – Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même l’expert, au demeurant, inscrit près la cour d’appel concernée aurait rendu un rapport très précis et documenté.
NB – v. not. Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.614 et nos obs. C’est encore et toujours la même règle de procédure civile qui est appliquée en l’espèce au droit de l’indivision. Une expertise privée est un moyen de preuve parfaitement admissible, mais à deux conditions : qu’elle soit soumise à débat contradictoire ET qu’elle ne constitue pas le seul élément de preuve sur lequel le juge fonde sa décision. C’est cette deuxième condition qui faisait défaut en l’espèce, et peu importe que l’Expert soit inscrit sur la liste expertale de la cour d’appel et que son rapport soit aussi détaillé qu’une encyclopédie. Il faut d’autres éléments de preuve en complément de l’expertise, voilà tout…
Interrogé, lors de la liquidation, sur le remploi du prix de vente du véhicule au profit de la communauté, un époux doit répondre précisément (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 19-24.485) – Si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun. En l’occurrence, une cour d’appel n’a nullement caractériser le remploi du prix de vente du véhicule au profit de la communauté en retenant, pour rejeter la demande de l’épouse tendant à la réintégration dans l’actif communautaire de la valeur du véhicule acquis en 2006 avec des fonds communs, que l’époux a vendu ce véhicule en mars 2007 au prix de 29 820,50 €, que le couple a perçu en 2007 des salaires annuels de 108 602 €, des dividendes de 37 591 €, et des revenus fonciers de 12 680 € et que l’épouse reconnaît que son époux a porté sur les comptes joints un revenu de 120 067 €, à la date de la revente du véhicule.
NB – Cet arrêt n’est jamais que la reprise d’une jurisprudence désormais très installée, depuis plus de quinze ans. En régime de communauté, si les époux sont présumés agir dans l’intérêt de la communauté (en usant de fonds communs, ou, comme en l’espèce, en disposant seul du prix de vente d’une voiture commune), ils ne sont pas dispensés de rendre des comptes sur le devenir de ces sommes. C’est pourquoi la Cour de cassation impose un devoir de loyauté à l’heure de la liquidation, dès lors que le conjoint demande ce que sont devenus les fonds en question. D’où la formule usuelle du motif de cassation (“s’il en est requis” : ce devoir de loyauté ne donnera lieu à reddition de comptes que si le conjoint le demande) complétée par l’énoncé de l’obligation d’informer le conjoint de “l’affectation” des fonds. Notons que cette obligation ne vaut que pour “les sommes importantes”, ce qui est normal : on ne va pas questionner le dépositaire des fonds pour quelques euros. Gardons cependant à l’esprit que la notion de “sommes importantes” est subjective et que dans l’un des précédents la “somme importante” était inférieure à 4 000 €. Il s’agit donc de sommes “importantes” à l’échelle du dossier considéré. Enfin, soulignons que cette jurisprudence est un minimum au plan liquidatif, car l’époux qui refuserait de dévoiler “l’affectation” des fonds litigieux ne devra restituer à la masse indivise que le nominal des sommes disparues. S’il les a investies dans un bien ayant pris de la valeur, la plus-value sera pour lui seul, il ne la partagera pas… Le silence qu’il garde vaut donc, potentiellement de l’or. C’est donc bien le moins qu’il restitue, a minima, le montant nominal perçu…
La décision rendue en matière de divorce du chef de l’exception de litispendance est revêtue de l’autorité de chose jugée, l’appel étant immédiatement recevable (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-19.640) – Selon l’article 15 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État à la condition, notamment, que la décision ne soit pas contraire à une décision judiciaire rendue dans l’État requis et y ayant l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de l’article 1110 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 que, en matière de divorce, l’exception de litispendance ne peut être invoquée que devant le JAF avant toute tentative de conciliation. La décision rendue de ce chef est revêtue de l’autorité de chose jugée et l’appel est immédiatement recevable, même si l’ordonnance rendue ne met pas fin à l’instance.
Viole ces deux textes la cour d’appel qui, pour décider que le jugement de divorce prononcé en Tunisie n’était pas contraire à l’ONC, passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel, qui avait auparavant rejeté l’exception de litispendance au motif de l’incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l’irrégularité du jugement à intervenir, retient que le JAF n’a statué quant à la compétence et à la loi applicable que pour la conciliation prévue aux articles 252 à 257 du code civil, sans préjuger de la compétence du juge qui serait saisi au fond de l’instance en divorce.
Le pourvoi en cassation contre le prononcé du divorce laisse son auteur marié à son défunt mari (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-19.593) Selon les articles 227 et 260 du code civil, le mariage se dissout par la mort de l’un des époux. Par suite, l’action en divorce s’éteint par le décès de l’un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. En l’occurrence l’ex-épouse s’est pourvue en cassation contre l’arrêt qui a prononcé son divorce d’avec son mari. Dès lors qu’il est justifié par un acte de l’état civil que ce dernier est décédé, l’action en divorce se trouve éteinte.
NB – Cette jurisprudence fort classique incite parfois à quelques stratégies inavouables (v. obs. S. David, ss. Civ. 1re, 20 juin 2006, n° 05-16.150, AJ fam. 2016).
INDIVISION
Demande de partage en nature et sort de l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 19-24.014) – Deux enseignements à tirer de cette décision :
. de l’art. 826 du code civil il résulte que, à défaut d’entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort et que, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions. En l’occurrence, la demande de partage en nature d’un bien indivis avec attribution au profit de chacun des indivisaires du lot afférent à ses droits ne pouvait être que rejetée dès lors que l’un des indivisaires s’y opposait ;
. l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil ; la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 du même code.
NB – Le premier enseignement est classique mais souvent mal perçu par les juges du fond. Alors il faut le répéter. À l’heure du partage judiciaire, il existe une hiérarchie dans les façons de parvenir au partage. Soit les parties s’entendent et composent les lots comme le veulent et se les attribuent de même. Soit les parties ne s’entendent pas assez pour procéder ainsi et, dans ce cas, un tiers (expert ou notaire) composera des lots d’égale valeur, lesquels seront ensuite tirés au sort (devant le notaire, plus rarement devant le juge). Aucune attribution nominative ne peut être décidée par le juge. Le hasard seul décide. Cas particulier (mais fréquent) : si les biens ne sont pas commodément partageables (ce qui implique que l’on ne parvient pas à faire des lots d’égale valeur), leur licitation devra être ordonnée par le juge et le partage se reportera sur le prix perçu (après la vente à la barre). Attention, la licitation par vente judiciaire est subsidiaire, elle ne saurait donc être imposée en première intention. Le juge qui l’ordonne devra donc vérifier que le partage en nature n’est pas “commodément” réalisable.
Le second point tranché par l’arrêt (rémunération de l’industrie de l’indivisaire ayant, par son travail, augmenté la valeur du bien indivis) correspond à une jurisprudence désormais stabilisée de la Cour de cassation qui fixe une claire ligne de répartition entre les articles 815-13 et 815-12 du code civil (mais il n’en fut pas toujours ainsi…). La plus-value accroît à l’indivision et doit être partagée entre les indivisaires (815-13), tandis que l’industrie de l’indivisaire ayant engendré cette plus-value est rémunéré sur le fondement de l’article 815-12 du code civil. Il s’agit donc de deux questions distinctes. Il est cependant dommage que le code ne détaille pas davantage les critères de rémunération de l’indivisaire-gérant, la pratique révélant que nombre de juges du fond procèdent à une décote sur la rémunération, et ne sont guère généreux dans les montants alloués, même quand l’intervention du gérant est très bénéfique en termes de plus-value pour les coïndivisaires. Cette jurisprudence est donc juste au regard de la répartition du domaine des textes, mais elle est souvent injuste dans sa mise en oeuvre…
LIBÉRALITÉS
Contrat d’assurance vie : la prescription décennale chasse la prescription quinquennale (Civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 20-10.013) – Lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, l’action relative à un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par dix ans en application de l’article L. 114-1, alinéa 4, du code des assurances et non par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Dès lors, une cour d’appel ne pouvait opposer la prescription quinquennale à l’épouse qui revendiquait la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par son défunt mari dont le bénéficiaire n’était pas le souscripteur et sollicitait la condamnation de la banque et de l’assureur au paiement de sommes en exécution de ce contrat. Par suite, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déclarant irrecevables les demandes de l’épouse formées contre la banque, ses enfants – qui se prétendaient bénéficiaires au terme d’un avenant contesté – et l’assureur entraîne la cassation des chefs de dispositif disant qu’il appartient à l’assureur de verser aux enfants bénéficiaires nouvellement désignés les fonds afférents au contrat d’assurance vie et en tant que de besoin, condamnant l’assureur au paiement desdites sommes, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. La cour de renvoi devra donc se pencher sur la nullité prétendue de l’avenant.
SUCCESSIONS
La qualité d’aide familial n’exclut pas le bénéfice d’un salaire différé (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 19-24.814).
Recel : intention frauduleuse et respect de l’objet du litige (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-11.678) – Premier rappel : un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil conformément à l’article 778 du code civil. Second rappel : selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Viole ce texte la cour d’appel qui, après avoir relevé que l’épouse avait continué à percevoir la prestation compensatoire sous forme de rente, alors qu’elle avait été convertie en capital, puis avait bénéficié de ce capital alors qu’en raison de son remariage avec son ex-mari, elle n’avait plus vocation à percevoir une prestation compensatoire, condamne celle-ci à restituer la somme de 112 894,85 € indûment perçue à ce titre à la succession. Ce faisant, elle a modifié l’objet du litige, alors qu’elle était saisie d’une action introduite sur le fondement du recel successoral et tendant à ce qu’elle soit condamnée à rapporter les sommes indûment perçues !
Jérôme Casey & Valérie Avena-Robardet
Copyright © 2010-2021 Forum Famille Dalloz