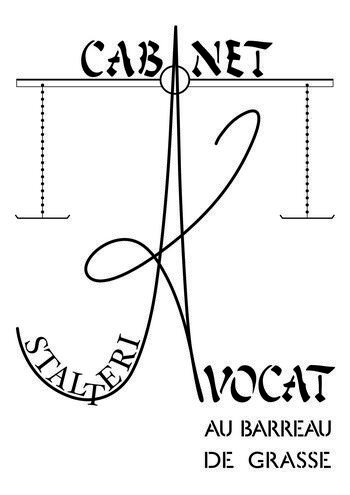Enfant à naître et disparition préjudiciable du grand-père
Décidément, la question de la réparation du préjudice de l'enfant à naître ne cesse de rebondir dans l'actualité jurisprudentielle. La Cour de cassation vient, cette fois, de valider le raisonnement d'une cour d'appel qui a admis la réparation du préjudice moral d'un enfant simplement conçu au moment du fait générateur ayant entraîné le décès de son grand-père.

Les faits sont tristement classiques. Un homme est tué par arme blanche et le coupable condamné pour meurtre en cour d'assise. La fille de la victime obtient réparation de son préjudice par ricochet. Ce qui est moins coutumier, c'est que cette dernière saisit ensuite la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour demander la réparation du préjudice moral subi par sa fille : la petite-fille de la victime conçue mais non encore née au moment de l'accident.
La question se posait donc nécessairement de l'admissibilité de cette réparation qui implique, une nouvelle fois, de s'interroger sur l'existence du lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice, comme de la réalité de ce dernier.
C'est justement sur ces deux difficultés que reposait le moyen invoqué par le Fonds de garantie faisant grief à la décision de la cour d'appel.
La Cour de cassation répond de manière lapidaire et incisive sous forme d'un attendu de principe imprégné, pour l'occasion, des termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale : « L'enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès ». Elle rejette donc le pourvoi et juge que la cour d'appel a bien relevé que la petite-fille de la victime sera privée de la présence d'un grand-père et précise qu'il n'est pas nécessaire de justifier qu'elle aurait entretenu des liens particuliers d'affection avec lui si elle l'avait connu.
Des confirmations
Il existe désormais en comptant celle-ci, et à notre connaissance, trois décisions de la Cour de cassation qui ont admis la possibilité de réparer le préjudice moral d'un enfant simplement conçu lors de la survenance du fait générateur de responsabilité. La première a été rendue par la deuxième chambre civile, dans un arrêt retentissant du 14 décembre 2017 (Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16-26.687, Dalloz actualité, 10 janv. 2018, obs. A. Hacène ; D. 2018. 386, note M. Bacache ; ibid. 2153, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2019. 38, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; AJ fam. 2018. 48, obs. M. Saulier ; RDSS 2018. 178, obs. T. Tauran ; RTD civ. 2018. 72, obs. D. Mazeaud ; ibid. 92, obs. A.-M. Leroyer ; ibid. 126, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal. 2018. 214, note M. Dupré ; Lexbase, n° N2094BXT, note H. Conte). La seconde a été rendue par la chambre criminelle le 10 novembre 2020 (Crim. 10 nov. 2020, n° 19-87.136, Dalloz actualité, 15 déc. 2020, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 2288 ; AJ fam. 2020. 679, obs. L. Mary ; AJ pénal 2021. 31, note Y. Mayaud ; RJPF 1er jan. 2020, note M. Dupré ; RCA n° 1, janv. 2021. Comm. 2, note S. Hocquet-Berg). C'est donc, de nouveau, devant la deuxième chambre civile que la question sur le préjudice moral de l'enfant à naître se posait. Néanmoins, il s'agissait ici de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui prévoit que « toute personne […] ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne […] ». Si les conditions de ce régime sont particulières, rien ne semble toutefois empêcher qu'une telle solution soit réitérée lors d'une application future du droit commun.
La question de l'admission de la créance de réparation à l'égard de l'enfant à naître a suscité de nombreux débats en doctrine. Il s'agissait, notamment, de déterminer si les juges du droit font nécessairement application de l'adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodise jus habetur pour admettre la créance de réparation à l'égard de l'enfant. Cet adage hérité du droit romain permet, en effet, de faire rétroagir la personnalité juridique de l'enfant né vivant et viable à la date de sa conception pour lui permettre de bénéficier de droits chaque fois qu'il y va de son intérêt. Nous avons déjà eu l'occasion de soutenir que le recours à ce fondement n'est pas nécessaire pour admettre la créance de réparation car il importe peu qu'il ait existé un laps de temps important entre la survenance du fait générateur et la naissance du droit à la réparation à condition de se trouver dans les limites légales de la prescription (v. H. Conte, Le droit à la réparation du préjudice moral de l'enfant à naître, Lexbase n° 726, 11 janv. 2018, n° N2094BXT). La créance de réparation naît ici au moment de la naissance et, au jour de celle-ci, le nourrisson est bien capable d'être titulaire de cette créance. À l'inverse, le recours à l'adage est parfois défendu comme étant nécessaire pour admettre l'existence du lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice : « Le lien de causalité est de la sorte apprécié à la date du fait générateur, même si le dommage n'apparaît qu'après la naissance de l'enfant » (M. Bacache, Nouveau préjudice moral pour l'enfant conçu au jour du décès accidentel de son père, D. 2018. 386, n° 11). En appréciant le lien de causalité à la date du fait générateur grâce à l'adage infans conceptus, on empêche des événements (comme la naissance) de s'interposer entre le fait générateur et le préjudice et on redonne au lien de causalité son caractère direct certain. Cependant, est-il, là encore, nécessaire d'user de cet adage pour caractériser l'existence d'un lien de causalité ? La deuxième chambre civile, comme la chambre criminelle, se contente désormais de constater son existence se conformant ainsi à leur politique judiciaire indemnitaire très favorable aux victimes et ne fait d'ailleurs pas référence à l'adage. Il est aussi possible de penser que la Cour de cassation ne considère pas la naissance comme un événement susceptible de rompre la chaîne de causalité et apprécie son lien souplement.
Les auteurs qui voient dans ces arrêts l'application de l'adage infans conceptus le considèrent comme nécessaire car la naissance est la condition de l'existence du préjudice. À cet égard, la question d'une causalité certaine ne se pose que si la naissance n'a pas eu lieu ou que l'enfant n'est pas né vivant et viable. Cependant, comme la question ne peut prendre le chemin du tribunal que lorsque l'enfant est bien né, est-il toujours nécessaire de se poser la question du lien de causalité ? Au train où vont les choses, il ne serait pas étonnant que la boîte de Pandore continue de s'entrouvrir et que l'enfant puisse demander, demain, réparation du préjudice moral éprouvé par l'impossibilité d'avoir pu nouer des relations avec ses beaux-parents ou encore ses cousins.
La confirmation se retrouve aussi dans la reconnaissance d'un nouveau chef de préjudice, celui de ne pas avoir pu nouer des liens affectifs avec un membre de sa famille. Il s'agit d'un préjudice objectif et présumé car le demandeur ne connaîtra jamais la victime directe et n'aura jamais besoin de prouver la réalité de ce préjudice en expliquant la teneur de ses liens affectifs avec elle.
Des extensions. Alors que les arrêts précédents évoquaient explicitement la construction identitaire avec le père, l'arrêt du 11 février évoque la privation « de la présence de son grand-père dont [la victime] avait vocation à bénéficier ». La chambre criminelle, en particulier, s'était attardée sur la motivation de la cour d'appel qui insistait sur les liens entre père et fils : « Les juges retiennent que l'absence de C… Y… auprès de son fils B… sera toujours ressentie douloureusement par l'enfant qui devra se contenter des souvenirs de sa mère et de ceux de ses proches pour connaître son père et construire son identité, et que B… souffrira de l'absence définitive de son père, qu'il ne connaîtra jamais, toute sa vie ». Cela a poussé certains auteurs à penser que la réparation ne serait pas ouverte aux grands-parents du fait, justement, de la nature particulière des liens père/enfant et de leur utilité dans la construction identitaire de ce dernier (v. M. Dupré, Le préjudice de l'enfant à naître : la comparaison est-elle raison ?, RJPF, n° 1, 1er janv. 2021). La Cour de cassation vient ici expliquer qu'il n'en est rien. Soit elle met sur le même piédestal la relation parent/enfant et grand-parent/enfant, soit il s'agit d'un nouveau chef de préjudice qui consiste dans « l'absence définitive d'un parent » (au sens large du terme) et qui côtoiera celui consacré en 2017. L'intérêt de la création d'un chef de préjudice nouveau propre aux grands-parents est de pouvoir indemniser la victime moins largement que s'il s'agissait des parents stricto sensu (père et mère). Puisqu'il s'agit d'un préjudice objectif et présumé, les sommes devraient être toujours les mêmes. En 2017, la somme allouée était de 25 000 €. Il serait raisonnable de ne pas attribuer la même somme dans le cas de la privation de la présence d'un grand-père. Sur ce point, la reconnaissance d'un préjudice de perte de chance de pouvoir nouer des relations avec un membre de sa famille aurait suffi pour limiter l'inflation et le morcellement du préjudice moral. En effet, le préjudice de perte de chance a l'avantage de limiter le montant accordé à la victime. C'est un chef de préjudice qui induit que le lien de causalité n'est pas établi avec certitude comme dans le cas d'espèce. Ici, la perte de chance de pouvoir nouer des relations avec un membre de sa famille est un événement favorable qui existe réellement et il est bien entendu que cette chance a été perdue par le concours du fait générateur. Cela contribuerait ainsi à ne plus le présumer ce poste de préjudice. Il reviendrait alors à la victime de démontrer que le grand-père avait noué une forte relation avec un petit-enfant né auparavant et que rien ne puisse indiquer qu'il n'en aurait pas été de même avec le nouveau-né (cela était invoqué dans les moyens annexes).
Rappelons enfin qu'à moins que le Fonds d'indemnisation parvienne à récupérer les sommes auprès de l'auteur des faits (ce qui n'est pas fréquent), c'est ici la solidarité nationale qui prend la charge de la réparation [ou plutôt la solidarité des assurés]. La décision est donc aussi étonnante sur ce point tant l'on sait les difficultés qu'ont connues les victimes indirectes pour se faire indemniser sur ce fondement. Le Fonds refusait systématiquement l'indemnisation au motif que, reposant sur la solidarité nationale, elle devrait être réservée à la victime directe de l'infraction (v. J.-Cl. pr. pén., par H. Groutel, fasc. 20, art. 706-3 à 706-15, nos 83 s.). Il a fallu que la Cour de cassation intervienne pour « vaincre la résistance du Fonds » (H. Groutel, préc. ; v. les arrêts cités par l'auteur : Civ. 2e, 14 janv. 1998, n° 96-16.255, D. 1998. 52 ; RCA 1998. Comm. 92, note H. Groutel ; Dr. pén. 1998. Comm. 45, note A. Maron ; 14 janv. 1999, n° 96-19.289, Bull. civ. II, n° 11 ; D. 1999. 49 ; RCA 1999. Comm. 69 ; 27 mai 1999, n° 97-19.652, RCA 1999. Comm. 262 ; 7 oct. 1999, n° 98-11.450, RCA 1999. Comm. 361 ; 20 janv. 2000, n° 98-15.359).
L'occasion était donnée une nouvelle fois à la Cour de cassation d'élargir le nombre de victimes susceptibles de pouvoir exiger une indemnisation, ce qu'elle n'a pas manqué de faire.
Par Henri Conte
Source : Civ. 2e, 11 févr. 2021, F-P+I, n° 19-23.525
© DALLOZ 2021